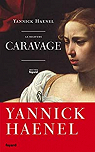Citation de Partemps
Je m’arrête un instant à Messine, face à La Résurrection de Lazare. On est en 1609. Le Caravage approfondit une solitude qui le dépouille ; il s’abîme dans une obscurité qui se resserre sur son souffle ; on dirait qu’il disparaît : d’ailleurs on ne sait plus rien sur lui -où vit-il ? avec qui parle-t-il ? Le Caravage rejoint son propre mystère. C’est la nuit, et il peint : sa main, dans l’ombre, trace de brusques lueurs qui, en fouillant l’épaisseur du péché, scintillent à la recherche de la grâce.
Il arrive qu’à force de regarder des peintures on se mette à voir quelque chose de très simple ; et que cette simplicité se change en lumière.
Depuis que je m’aventure à écrire sur la vie et l’art du Caravage — depuis qu’avec ce livre je me suis mis à chercher dans la matière de la peinture une vérité qui pourrait se dire —, je suis guetté par un mouvement qui abandonne mes phrases en même temps qu’il les appelle : elles semblent partir dans des directions qui m’échappent, et je ne les reconnais pas toujours ; mais je les laisse faire, car il me vient avec elles l’espérance qu’en se perdant elles parviennent à s’éclairer d’une lumière qui n’est pas seulement raisonnable, à glisser vers je ne sais quoi de plus ouvert que leur sens, à entrer dans un pays plus inconnu encore que la poésie, où la vérité fait des apparitions étranges, comme s’il existait encore autre chose que la nuit et le jour, un temps qui échappe à leur contradiction, qui n’a rien à voir avec leur succession, qui défait le visible en même temps que l’invisible.
La peinture a lieu ici, à ce point d’éclat où l’on ne s’appartient plus, où le Caravage échappe non seulement à ses bourreaux, à ses ennemis, aux chevaliers de l’Ordre, à la mort qui le condamne et prend chaque jour une forme différente, mais aussi à ses mécènes, à ses amis, à ses amours, à tous ceux qu’il connaît à Rome, à Malte, à Syracuse ou à Naples, à tous ceux qu’il ne connaît pas et dont il redoute les désirs et le ressentiment.
Là, le visible s’efface ; et ne dépend plus de rien, ni du temps ni de l’espace, ni des histoires personnelles ni d’aucune conception sur l’art. La peinture et le mystère se rejoignent, comme ils se sont rejoints un jour sur un mur de la grotte de Lascaux, comme ils continuent à coïncider par fois, follement, sans qu’on puisse savoir pourquoi ni comment.
La solitude du Caravage réside dans cet emportement qui l’amène à vivre la peinture comme un moyen pour atteindre le mystère ; et à vivre le mystère comme un moyen pour atteindre la peinture. Ce mystère serait-il le nom de quelque chose de plus grand que nous, ou le rien à quoi nos vies sont mêlées et vers quoi elles se compriment, il n’affirme de toute façon qu’une chose qui manque. Parfois, rien n’est plus clair.
Alors voici :à force de regarder la peinture du Caravage et de m’interroger sur son expérience intérieure, sur la nature de son angoisse, sur la progression du péché dans sa vie et l’intensité de ce qui, à la fois, le sépare et le rapproche de la lumière, je me suis aperçu que de tableau en tableau, centimètre après centimètre, il se rapprochait du Christ.
L’histoire du rapport entre le Caravage et le Christ mériterait la matière d’un livre entier ; en un sens, c’est l’objet de celui-ci -mais il n’est pas si facile d’y accéder :un tel objet ne peut être abordé qu’à travers les tours et détours d’une passion, elle-même hésitante et emportée, timide et contradictoire, qui avance et recule, s’enflamme, se refroidit — s’interroge : il faut du temps, des phrases, et la capacité de convertir la pensée qui vient de ces phrases et de ce temps en une expérience, c’est-à-dire un récit.
Autrement dit, il faut en passer par de la littérature :elle seule, aujourd’hui que l’ensemble des savoirs s’est rendu disponible à travers l’instantanéité d’un réseau planétaire qui égalise tous les discours et les réduit à déferler sous la forme d’une communication dévitalisée, se concentre sur la possibilité de sa solitude ;elle seule, par l’attention qu’elle ne cesse de développer à l’égard de ce qui rend si difficile l’usage du langage, donne sur l’abîme ; elle seule prend le temps de déployer une parole qui cherche et qui soit susceptible, à travers ses enveloppements, de faire face au néant, de détecter des brèches, de susciter des passages, de trouver des lumières.
Au fil des années, le Caravage se rapproche du Christ :on le mesure en observant l’évolution de leur distance dans les tableaux. En 1599, ils ne sont pas encore dans le même cadre : alors que Jésus se tient dans La Vocation de saint Matthieu, le Caravage est dans Le Martyre, le tableau d’en face — il est présent, d’une manière douloureuse, aux côtés du crime, plutôt que dans l’aura de la vocation. On a vu qu’il se contente de lancer, d’une toile à l’autre, un regard angoissé, honteux et peut-être défiant au Christ. L’innocence est impossible ; le Caravage est enfoncé dans l’épaisseur du péché ; et pourtant, il n’a pas encore tué.
À peine quatre ans plus tard, en 1603, le voici de plain-pied avec Jésus : il est présent dans la scène de L’Arrestation du Christ, ce tableau saisissant, plein de tumulte et de cris nocturnes, qu’on peut voir à la National Gallery de Dublin, où, dans une extraordinaire mêlée à sept personnages comprimés dans un étau de ténèbres, des soldats en armure s’emparent du Christ que Judas, aux traits déformés par la laideur morale, vient de trahir.
Tandis que le Christ, mains jointes et la tête enveloppée d’un large pan de manteau rouge qui protège sa lumière intérieure comme un dôme angélique, détourne son regard de ses agresseurs avec une douceur affligée, quelqu’un, isolé à droite du tableau et qui ne fait partie ni de la troupe des soldats ni de celle des apôtres, émerge de la masse en s’efforçant d’éclairer la scène à l’aide d’une lanterne qu’il lève au-dessus des têtes ; son visage est fatigué, mais il est dans la lumière, le regard tourné vers le Christ dont il essaie de s’approcher : c’est lui, c’est le Caravage. Le sens de cette métaphore est clair : par son art, le peintre s’efforce de se rendre présent aux temps sacrés, il éclaire le monde depuis l’invisible auquel l’ouvre la peinture ; mais on peut penser que, avec son visage levé avidement vers la scène, le Caravage fait plus qu’éclairer son atelier mental. Ses yeux tourmentés et sa bouche ouverte expriment une attente, comme si le Caravage cherchait avant tout à se rapprocher du Christ. Mais le salut n’est pas à sa portée : entre le Christ et lui, l’espace est bloqué (par des corps, par les fautes du Caravage) — la distance est encore grande entre les deux.
Et nous voici donc en 1609, en Sicile, à Messine : le Caravage est condamné à mort par le pape, recherché par l’Ordre de Malte, cerné par une vendetta personnelle ; il se cache et il peint - il n’y a pas plus seul au monde que lui.
En six ans, il a énormément peint le Christ, on se souvient, entre autres, des deux Flagellation. Voici qu’à grands traits ocre, rouges et noirs, négligeant désormais le détail des carnations pour approfondir avec plus d’intensité l’espace dramatique où entre vie et mort s’agitent les humains, il se consacre à ce qui est peut-être son plus grand tableau, le plus audacieux : La Résurrection de Lazare.
Il arrive qu’à force de regarder des peintures on se mette à voir quelque chose de très simple ; et que cette simplicité se change en lumière.
Depuis que je m’aventure à écrire sur la vie et l’art du Caravage — depuis qu’avec ce livre je me suis mis à chercher dans la matière de la peinture une vérité qui pourrait se dire —, je suis guetté par un mouvement qui abandonne mes phrases en même temps qu’il les appelle : elles semblent partir dans des directions qui m’échappent, et je ne les reconnais pas toujours ; mais je les laisse faire, car il me vient avec elles l’espérance qu’en se perdant elles parviennent à s’éclairer d’une lumière qui n’est pas seulement raisonnable, à glisser vers je ne sais quoi de plus ouvert que leur sens, à entrer dans un pays plus inconnu encore que la poésie, où la vérité fait des apparitions étranges, comme s’il existait encore autre chose que la nuit et le jour, un temps qui échappe à leur contradiction, qui n’a rien à voir avec leur succession, qui défait le visible en même temps que l’invisible.
La peinture a lieu ici, à ce point d’éclat où l’on ne s’appartient plus, où le Caravage échappe non seulement à ses bourreaux, à ses ennemis, aux chevaliers de l’Ordre, à la mort qui le condamne et prend chaque jour une forme différente, mais aussi à ses mécènes, à ses amis, à ses amours, à tous ceux qu’il connaît à Rome, à Malte, à Syracuse ou à Naples, à tous ceux qu’il ne connaît pas et dont il redoute les désirs et le ressentiment.
Là, le visible s’efface ; et ne dépend plus de rien, ni du temps ni de l’espace, ni des histoires personnelles ni d’aucune conception sur l’art. La peinture et le mystère se rejoignent, comme ils se sont rejoints un jour sur un mur de la grotte de Lascaux, comme ils continuent à coïncider par fois, follement, sans qu’on puisse savoir pourquoi ni comment.
La solitude du Caravage réside dans cet emportement qui l’amène à vivre la peinture comme un moyen pour atteindre le mystère ; et à vivre le mystère comme un moyen pour atteindre la peinture. Ce mystère serait-il le nom de quelque chose de plus grand que nous, ou le rien à quoi nos vies sont mêlées et vers quoi elles se compriment, il n’affirme de toute façon qu’une chose qui manque. Parfois, rien n’est plus clair.
Alors voici :à force de regarder la peinture du Caravage et de m’interroger sur son expérience intérieure, sur la nature de son angoisse, sur la progression du péché dans sa vie et l’intensité de ce qui, à la fois, le sépare et le rapproche de la lumière, je me suis aperçu que de tableau en tableau, centimètre après centimètre, il se rapprochait du Christ.
L’histoire du rapport entre le Caravage et le Christ mériterait la matière d’un livre entier ; en un sens, c’est l’objet de celui-ci -mais il n’est pas si facile d’y accéder :un tel objet ne peut être abordé qu’à travers les tours et détours d’une passion, elle-même hésitante et emportée, timide et contradictoire, qui avance et recule, s’enflamme, se refroidit — s’interroge : il faut du temps, des phrases, et la capacité de convertir la pensée qui vient de ces phrases et de ce temps en une expérience, c’est-à-dire un récit.
Autrement dit, il faut en passer par de la littérature :elle seule, aujourd’hui que l’ensemble des savoirs s’est rendu disponible à travers l’instantanéité d’un réseau planétaire qui égalise tous les discours et les réduit à déferler sous la forme d’une communication dévitalisée, se concentre sur la possibilité de sa solitude ;elle seule, par l’attention qu’elle ne cesse de développer à l’égard de ce qui rend si difficile l’usage du langage, donne sur l’abîme ; elle seule prend le temps de déployer une parole qui cherche et qui soit susceptible, à travers ses enveloppements, de faire face au néant, de détecter des brèches, de susciter des passages, de trouver des lumières.
Au fil des années, le Caravage se rapproche du Christ :on le mesure en observant l’évolution de leur distance dans les tableaux. En 1599, ils ne sont pas encore dans le même cadre : alors que Jésus se tient dans La Vocation de saint Matthieu, le Caravage est dans Le Martyre, le tableau d’en face — il est présent, d’une manière douloureuse, aux côtés du crime, plutôt que dans l’aura de la vocation. On a vu qu’il se contente de lancer, d’une toile à l’autre, un regard angoissé, honteux et peut-être défiant au Christ. L’innocence est impossible ; le Caravage est enfoncé dans l’épaisseur du péché ; et pourtant, il n’a pas encore tué.
À peine quatre ans plus tard, en 1603, le voici de plain-pied avec Jésus : il est présent dans la scène de L’Arrestation du Christ, ce tableau saisissant, plein de tumulte et de cris nocturnes, qu’on peut voir à la National Gallery de Dublin, où, dans une extraordinaire mêlée à sept personnages comprimés dans un étau de ténèbres, des soldats en armure s’emparent du Christ que Judas, aux traits déformés par la laideur morale, vient de trahir.
Tandis que le Christ, mains jointes et la tête enveloppée d’un large pan de manteau rouge qui protège sa lumière intérieure comme un dôme angélique, détourne son regard de ses agresseurs avec une douceur affligée, quelqu’un, isolé à droite du tableau et qui ne fait partie ni de la troupe des soldats ni de celle des apôtres, émerge de la masse en s’efforçant d’éclairer la scène à l’aide d’une lanterne qu’il lève au-dessus des têtes ; son visage est fatigué, mais il est dans la lumière, le regard tourné vers le Christ dont il essaie de s’approcher : c’est lui, c’est le Caravage. Le sens de cette métaphore est clair : par son art, le peintre s’efforce de se rendre présent aux temps sacrés, il éclaire le monde depuis l’invisible auquel l’ouvre la peinture ; mais on peut penser que, avec son visage levé avidement vers la scène, le Caravage fait plus qu’éclairer son atelier mental. Ses yeux tourmentés et sa bouche ouverte expriment une attente, comme si le Caravage cherchait avant tout à se rapprocher du Christ. Mais le salut n’est pas à sa portée : entre le Christ et lui, l’espace est bloqué (par des corps, par les fautes du Caravage) — la distance est encore grande entre les deux.
Et nous voici donc en 1609, en Sicile, à Messine : le Caravage est condamné à mort par le pape, recherché par l’Ordre de Malte, cerné par une vendetta personnelle ; il se cache et il peint - il n’y a pas plus seul au monde que lui.
En six ans, il a énormément peint le Christ, on se souvient, entre autres, des deux Flagellation. Voici qu’à grands traits ocre, rouges et noirs, négligeant désormais le détail des carnations pour approfondir avec plus d’intensité l’espace dramatique où entre vie et mort s’agitent les humains, il se consacre à ce qui est peut-être son plus grand tableau, le plus audacieux : La Résurrection de Lazare.