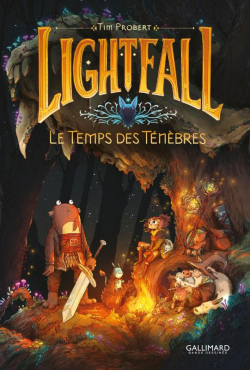Miguel BenasayagThierry Murat/5
17 notes
Résumé :
Avec cette lecture dessinée, Thierry Murat et Miguel Benasayag enrichissent et actualisent les arguments de l'essai Cerveau augmenté, homme diminué, face à l'explosion en cours de la numérisation de nos sociétés et au discours transhumaniste pour qui le cerveau serait comparable à un ordinateur que l'on pourrait optimiser à l'envi. « Le rêve d'un cerveau parfait est une illusion dangereuse » prévient le philosophe...
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Cerveaux augmentés (humanité diminuée ?)Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (8)
Voir plus
Ajouter une critique
Le cerveau ne voit pas, n'entend pas ne parle pas, ni ne pense.
-
Ce tome contient une histoire complète, indépendante de toute autre, plutôt une réflexion sur le sujet. Sa publication originale date de 2023. Il a été réalisé conjointement par Miguel Benasayag pour le livre original Cerveau augmenté, homme diminué (2016) et pour la discussion, avec Thierry Murat bédéiste qui en a réalisé cette adaptation, ou plutôt cette lecture commentée. Il s'agit d'un ouvrage en noir & blanc avec une teinte marron. Il comprend cent-quatre-vingt-deux pages de bande dessinée.
Un courriel du 21 juillet 2021 à 15h32 : Thierry indique à Miguel qu'il est en possession de son adresse mail. Les éditions Delcourt via les éditions La Découverte la lui ont gentiment communiquée, à la demande du philosophe. Il le remercie pour cette délicate attention, et lui propose de se parler un peu au téléphone, un de ces jours d'été afin de faire connaissance. Miguel lui répond un peu plus tard : il est très content de la proposition et indique qu'ils peuvent aussi se parler par Skype, un de ces prochains jours. Cela désole le bédéiste car il déteste Skype, il déteste tous ces moyens de communication où l'on est obligé de regarder bouger virtuellement les lèvres de son interlocuteur. Ça le stresse et il déteste le stress. Malgré tout il lui répond que ça lui va, et que l'application est installée sur la tablette de sa fille dont il lui communique l'adresse. S'en suivent quelques échanges. Thierry se souvient que chez Paul Auster, dans Cité de verre, c'est un faux numéro de téléphone qui déclenche tout. Là, c'est une véritable lettre qui est à l'origine de cette bande dessinée, celle que Thierry a adressée au philosophe pour adapter son livre.
Après des échanges téléphoniques, l'artiste met son projet en suspens quelques semaines car il est invité par l'alliance française en Colombie. Dans l'avion, n'arrivant pas à choisir dans la multitude de films à regarder, il repense au dilemme de l'âne idiot de Buridan. Finalement il s'endort. Rêver que l'on est en train de dormir, ou rêver que l'on est en train de rêver, est un état de conscience tout aussi vertigineux que l'étude de l'objet par l'objet lui-même. Depuis la nuit des temps, le cerveau humain observe, connaît, étudie, s'explique des choses, comprend… Mais à partir du XXIe siècle, grâce aux récentes avancées en imagerie médicale, en biochimie, en neurosciences, le cerveau humain en est arrivé au stade où il est devenu… son propre sujet d'étude. Cette auto-rencontre est une rupture anthropologique sans précédent, certainement la quatrième blessure narcissique de l'humanité. Les trois premières blessures narcissiques, infligées par la science à l'homme dans l'histoire de l'Occident, on le sait, furent douloureuses et le sont peut-être encore. La première déclenchée par Copernic et Galilée : non seulement la Terre n'est pas au centre de l'univers, sous le regard de plein d'amour paternel de Dieu, mais elle n'est qu'un simple caillou parmi tant d'autres, perdu dans l'infini intersidéral. La deuxième, causée par Darwin…
Au cours de la bande dessinée, le bédéiste indique que les éditeurs qualifient ce genre d'ouvrage d'Essai graphique, terme repris dans le texte de la quatrième de couverture. S'il lui prend l'envie de feuilleter l'ouvrage pour s'en faire une première idée, le lecteur découvre des illustrations disposées en case, à raison en moyenne de trois par page, avec des cartouches de texte plus ou moins copieux, une forme de bande dessinée, mais pas de narration séquentielle. S'il n'est pas a priori attiré par le sujet ou par l'auteur, il est possible qu'il en reste là, craignant une lecture fastidieuse, et peut-être intellectuelle dans le mauvais sens du terme. Sinon, il franchit le pas en pleine connaissance de cause, et il éprouve la surprise de d'une lecture agréable, même s'il ne s'agit pas effectivement d'une narration traditionnelle en bande dessinée. le bédéiste aborde explicitement cette question au cours de l'ouvrage en disant : On s'imagine souvent que la bande dessinée doit formellement et absolument mettre en scène des bonshommes à gros nez, bavardant frénétiquement à grands coups de phylactère ovoïde… Il continue : Certains lecteurs auront alors été un peu déstabilisés à la lecture des premières pages du présent ouvrage, où il s'essaie librement à ce genre nouveau que les éditeurs, les libraires et les journalistes de la modernité ont baptisé : l'essai graphique. Il s'agit surtout, là aussi, de créer un monde pour inventer une forme narrative. Ne pas prendre le lecteur pour un âne. Ne pas se contenter de penser que l'on a trouvé ce qu'on cherche en illustrant un catéchisme savant… Ne pas se faire croire que le lecteur doit systématiquement être en position confortable. Chercher. Essayer… Oser surestimer ce qui se passe entre les cases, et y explorer cette temporalité alternative de la lecture que permet le médium Bande dessinée. Les idées visuelles enfermées dans des cases ne sont rien avant de prendre corps entre les mains du lecteur. Libre à lui d'en faire des points d'exclamation, d'interrogation, ou de suspension.
Seconde originalité dans cet ouvrage, Thierry Murat fait plus que simplement mettre en image le livre du philosophe franco-argentin : il en reprend la structure, les thèmes, la logique, et il évoque son dialogue avec l'auteur sur différents passages, sur certains questionnements, évoquant également la résonnance avec son quotidien ou ses propres choix. Ce parti pris constitue effectivement un prolongement de l'ouvrage initial, et le lecteur peut faire l'expérience de la rencontre entre ces deux auteurs, de leurs idées communes, exprimées chacun à leur manière. Ce principe est affiché dès les première pages dans lesquelles le bédéiste alterne des images de circuits imprimés schématisés, avec les paysages des Landes en mode semi-nocturne, alors qu'il conduit sa voiture, opposant ainsi le minéral du silicone au paysage ouvert des silhouettes d'arbres et des oiseaux dans le ciel. Dans le même temps, il évoque le processus laborieux de prise de contact directe avec le philosophe, et sa réticence à utiliser un logiciel de visioconférence. Les auteurs mettent en scène l'opposition entre l'artificialité du monde numérique et le vivant organique du réel. Enfin une première conversation téléphonique peut avoir lieu, puis Murat doit différer la réalisation de ce projet du fait de son départ pour la Colombie. Puis le dessinateur évoque le paradoxe de l'âne de Buridan (Jean Buridan, 1292-1363, philosophe français) : cette question philosophique est reprise par la suite sous un angle de logique, en évoquant Deep Blue, développé par IBM au début des années 1990, le logiciel qui a battu Gary Kasparov aux échecs en 1997.
Le lecteur se prend rapidement au jeu de la lecture : les échanges entre les deux auteurs qui reprennent le processus de création de l'adaptation et de la bande dessinée, induisant à la fois une forme légère de mise en abîme, une lecture personnelle de l'oeuvre, une invitation à la prise de recul de la part du lecteur. le titre annonce clairement le positionnement des auteurs sur le sujet : le point d'interrogation étant quasiment superflu. En effet, Murat annonce qu'il a abandonné l'usage de tous les réseaux sociaux, Benasayag insistant dès le début sur la comparaison erronée entre le fonctionnement d'une intelligence artificielle et celle du cerveau. le titre de ses ouvrages parle d'eux-mêmes : La singularité du vivant (2017), Fonctionner ou exister (2018), La tyrannie des algorithmes (2019). Conscient du parti pris des auteurs, le lecteur relève plus facilement que tous les arguments contre le monde du numérique sont à charge. Il se rend compte des omissions sciemment effectuées ou de l'absence de mention des apports du numérique au sens large dans la vie quotidienne, ce qui ne diminue en rien le point de vue des auteurs. Dans cette forme unique, ils évoquent aussi bien les spécificités du fonctionnement organique du cerveau humain, que les techniques de captation de l'attention, le circuit de récompense de la dopamine, ou encore les conséquences des fonctions déléguées aux machines informatiques et aux algorithmes. Il s'agit donc d'une lecture active, se faisant tout naturellement, sans avoir besoin de s'arrêter pour réfléchir sciemment aux liens entre textes et images, au pourquoi du choix de telles illustrations.
L'artiste impressionne par son usage de silhouettes, d'icônes, de paysages naturels, de rapprochements visuels, de métaphores imagées. Il couvre tout le spectre de la représentation du dessin descriptif réaliste au symbole visuel, en passant par l'image conceptuelle à en être parfois abstraite si elle est prise hors de contexte de celle d'avant ou celle d'après (ce qui illustre le travail du cerveau pour identifier les schémas et produire du sens, ce qui se passe entre les cases), le facsimilé de bande dessinée humoristique (Les aventures de Thierry & Miguel), des dessins reproduisant des artefacts culturels comme un écran de Pac-Man, le tableau La Joconde, des affiches de réclame, des logos d'entreprise, d'autres oeuvres d'art (une sculpture d'Alberto Giacometti, 1901-1966), des écrans d'ordinateur d'avant l'interface graphique, des kanjis, etc., pour une grande diversité graphique que ne laisse pas supposer un simple feuilletage préalable.
Cet exposé graphique s'avère fort riche dans son ensemble. Il fait appel à de nombreux éléments cultures, par exemple : La cité de verre (1987) de Paul Auster, Moby Dick (1851), d'Herman Melville (1819-1891), la notion d'apercetion de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), La grande vague de Kanagawa (environ 1830) de Katsushika Hokusai (1760-1849), la qualité des pensées que l'on a en marchant d'après Friedrich Nietzsche (1844-1900), Blade Runner (1982) de Ridley Scott, l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg (1400-1468), la fable du scorpion et de la grenouille de Lev Nitoburg (1899-1937), le corps sans organe d'Antonin Artaud (1896-1948), l'utilité de l'inutile développé par Tchouang Tseu (-369 à -288), l'autobiographie de Corto Maltese (Le désir d'être inutile) par Hugo Pratt (1927-1995), lé dégénérescence des utopies par Claude Shannon (1916-2001, mathématicien, un des fondateurs de la théorie de l'information) & Norbert Wiener (1894-1964, père fondateur de la cybernétique), Bug (2017-2022) d'Enki Bilal, la notion de biopouvoir développée par Michel Foucault (1926-1984), le petit Prince (1943) d'Antoine Saint Exupéry (1900-1944), etc. Les auteurs savent apporter les informations nécessaires pour que tous les lecteurs puissent comprendre ces références et leur rapport avec l'exposé. Ainsi le lecteur saisit aisément la différence fondamentale entre le fonctionnement du cerveau et une intelligence informatique (Tout le corps pense… Pas seulement le cerveau.), la réalité déjà présente du transhumanisme (l'impact de l'omniprésence de l'information disponible en permanence par exemple), le problème avec le progrès (on voit ce qu'on gagne, mais on ignore ce qu'on perd), l'avènement de la société normative (ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas), le principe de mariage parfait qui unit aujourd'hui les technosciences et la macroéconomie néolibérale (deux formes d'une même dérégulation), etc.
Le titre indique clairement que les auteurs adoptent un point de vue partial sur la question, certainement pour compenser la généralisation et l'enthousiasme pour les technologies numériques sous toutes leurs formes. Malgré une apparence éloignée d'une bande dessinée traditionnelle, le lecteur se rend vite compte du confort de lecture, de l'intelligence de la mise en images, conçue sur mesure pour cet exposé graphique. Il apprécie les points de vue du philosophe grâce à la richesse des références, la clarté du propos, sans pour autant perdre son propre esprit critique. du grand art, de la réflexion très humaine.
-
Ce tome contient une histoire complète, indépendante de toute autre, plutôt une réflexion sur le sujet. Sa publication originale date de 2023. Il a été réalisé conjointement par Miguel Benasayag pour le livre original Cerveau augmenté, homme diminué (2016) et pour la discussion, avec Thierry Murat bédéiste qui en a réalisé cette adaptation, ou plutôt cette lecture commentée. Il s'agit d'un ouvrage en noir & blanc avec une teinte marron. Il comprend cent-quatre-vingt-deux pages de bande dessinée.
Un courriel du 21 juillet 2021 à 15h32 : Thierry indique à Miguel qu'il est en possession de son adresse mail. Les éditions Delcourt via les éditions La Découverte la lui ont gentiment communiquée, à la demande du philosophe. Il le remercie pour cette délicate attention, et lui propose de se parler un peu au téléphone, un de ces jours d'été afin de faire connaissance. Miguel lui répond un peu plus tard : il est très content de la proposition et indique qu'ils peuvent aussi se parler par Skype, un de ces prochains jours. Cela désole le bédéiste car il déteste Skype, il déteste tous ces moyens de communication où l'on est obligé de regarder bouger virtuellement les lèvres de son interlocuteur. Ça le stresse et il déteste le stress. Malgré tout il lui répond que ça lui va, et que l'application est installée sur la tablette de sa fille dont il lui communique l'adresse. S'en suivent quelques échanges. Thierry se souvient que chez Paul Auster, dans Cité de verre, c'est un faux numéro de téléphone qui déclenche tout. Là, c'est une véritable lettre qui est à l'origine de cette bande dessinée, celle que Thierry a adressée au philosophe pour adapter son livre.
Après des échanges téléphoniques, l'artiste met son projet en suspens quelques semaines car il est invité par l'alliance française en Colombie. Dans l'avion, n'arrivant pas à choisir dans la multitude de films à regarder, il repense au dilemme de l'âne idiot de Buridan. Finalement il s'endort. Rêver que l'on est en train de dormir, ou rêver que l'on est en train de rêver, est un état de conscience tout aussi vertigineux que l'étude de l'objet par l'objet lui-même. Depuis la nuit des temps, le cerveau humain observe, connaît, étudie, s'explique des choses, comprend… Mais à partir du XXIe siècle, grâce aux récentes avancées en imagerie médicale, en biochimie, en neurosciences, le cerveau humain en est arrivé au stade où il est devenu… son propre sujet d'étude. Cette auto-rencontre est une rupture anthropologique sans précédent, certainement la quatrième blessure narcissique de l'humanité. Les trois premières blessures narcissiques, infligées par la science à l'homme dans l'histoire de l'Occident, on le sait, furent douloureuses et le sont peut-être encore. La première déclenchée par Copernic et Galilée : non seulement la Terre n'est pas au centre de l'univers, sous le regard de plein d'amour paternel de Dieu, mais elle n'est qu'un simple caillou parmi tant d'autres, perdu dans l'infini intersidéral. La deuxième, causée par Darwin…
Au cours de la bande dessinée, le bédéiste indique que les éditeurs qualifient ce genre d'ouvrage d'Essai graphique, terme repris dans le texte de la quatrième de couverture. S'il lui prend l'envie de feuilleter l'ouvrage pour s'en faire une première idée, le lecteur découvre des illustrations disposées en case, à raison en moyenne de trois par page, avec des cartouches de texte plus ou moins copieux, une forme de bande dessinée, mais pas de narration séquentielle. S'il n'est pas a priori attiré par le sujet ou par l'auteur, il est possible qu'il en reste là, craignant une lecture fastidieuse, et peut-être intellectuelle dans le mauvais sens du terme. Sinon, il franchit le pas en pleine connaissance de cause, et il éprouve la surprise de d'une lecture agréable, même s'il ne s'agit pas effectivement d'une narration traditionnelle en bande dessinée. le bédéiste aborde explicitement cette question au cours de l'ouvrage en disant : On s'imagine souvent que la bande dessinée doit formellement et absolument mettre en scène des bonshommes à gros nez, bavardant frénétiquement à grands coups de phylactère ovoïde… Il continue : Certains lecteurs auront alors été un peu déstabilisés à la lecture des premières pages du présent ouvrage, où il s'essaie librement à ce genre nouveau que les éditeurs, les libraires et les journalistes de la modernité ont baptisé : l'essai graphique. Il s'agit surtout, là aussi, de créer un monde pour inventer une forme narrative. Ne pas prendre le lecteur pour un âne. Ne pas se contenter de penser que l'on a trouvé ce qu'on cherche en illustrant un catéchisme savant… Ne pas se faire croire que le lecteur doit systématiquement être en position confortable. Chercher. Essayer… Oser surestimer ce qui se passe entre les cases, et y explorer cette temporalité alternative de la lecture que permet le médium Bande dessinée. Les idées visuelles enfermées dans des cases ne sont rien avant de prendre corps entre les mains du lecteur. Libre à lui d'en faire des points d'exclamation, d'interrogation, ou de suspension.
Seconde originalité dans cet ouvrage, Thierry Murat fait plus que simplement mettre en image le livre du philosophe franco-argentin : il en reprend la structure, les thèmes, la logique, et il évoque son dialogue avec l'auteur sur différents passages, sur certains questionnements, évoquant également la résonnance avec son quotidien ou ses propres choix. Ce parti pris constitue effectivement un prolongement de l'ouvrage initial, et le lecteur peut faire l'expérience de la rencontre entre ces deux auteurs, de leurs idées communes, exprimées chacun à leur manière. Ce principe est affiché dès les première pages dans lesquelles le bédéiste alterne des images de circuits imprimés schématisés, avec les paysages des Landes en mode semi-nocturne, alors qu'il conduit sa voiture, opposant ainsi le minéral du silicone au paysage ouvert des silhouettes d'arbres et des oiseaux dans le ciel. Dans le même temps, il évoque le processus laborieux de prise de contact directe avec le philosophe, et sa réticence à utiliser un logiciel de visioconférence. Les auteurs mettent en scène l'opposition entre l'artificialité du monde numérique et le vivant organique du réel. Enfin une première conversation téléphonique peut avoir lieu, puis Murat doit différer la réalisation de ce projet du fait de son départ pour la Colombie. Puis le dessinateur évoque le paradoxe de l'âne de Buridan (Jean Buridan, 1292-1363, philosophe français) : cette question philosophique est reprise par la suite sous un angle de logique, en évoquant Deep Blue, développé par IBM au début des années 1990, le logiciel qui a battu Gary Kasparov aux échecs en 1997.
Le lecteur se prend rapidement au jeu de la lecture : les échanges entre les deux auteurs qui reprennent le processus de création de l'adaptation et de la bande dessinée, induisant à la fois une forme légère de mise en abîme, une lecture personnelle de l'oeuvre, une invitation à la prise de recul de la part du lecteur. le titre annonce clairement le positionnement des auteurs sur le sujet : le point d'interrogation étant quasiment superflu. En effet, Murat annonce qu'il a abandonné l'usage de tous les réseaux sociaux, Benasayag insistant dès le début sur la comparaison erronée entre le fonctionnement d'une intelligence artificielle et celle du cerveau. le titre de ses ouvrages parle d'eux-mêmes : La singularité du vivant (2017), Fonctionner ou exister (2018), La tyrannie des algorithmes (2019). Conscient du parti pris des auteurs, le lecteur relève plus facilement que tous les arguments contre le monde du numérique sont à charge. Il se rend compte des omissions sciemment effectuées ou de l'absence de mention des apports du numérique au sens large dans la vie quotidienne, ce qui ne diminue en rien le point de vue des auteurs. Dans cette forme unique, ils évoquent aussi bien les spécificités du fonctionnement organique du cerveau humain, que les techniques de captation de l'attention, le circuit de récompense de la dopamine, ou encore les conséquences des fonctions déléguées aux machines informatiques et aux algorithmes. Il s'agit donc d'une lecture active, se faisant tout naturellement, sans avoir besoin de s'arrêter pour réfléchir sciemment aux liens entre textes et images, au pourquoi du choix de telles illustrations.
L'artiste impressionne par son usage de silhouettes, d'icônes, de paysages naturels, de rapprochements visuels, de métaphores imagées. Il couvre tout le spectre de la représentation du dessin descriptif réaliste au symbole visuel, en passant par l'image conceptuelle à en être parfois abstraite si elle est prise hors de contexte de celle d'avant ou celle d'après (ce qui illustre le travail du cerveau pour identifier les schémas et produire du sens, ce qui se passe entre les cases), le facsimilé de bande dessinée humoristique (Les aventures de Thierry & Miguel), des dessins reproduisant des artefacts culturels comme un écran de Pac-Man, le tableau La Joconde, des affiches de réclame, des logos d'entreprise, d'autres oeuvres d'art (une sculpture d'Alberto Giacometti, 1901-1966), des écrans d'ordinateur d'avant l'interface graphique, des kanjis, etc., pour une grande diversité graphique que ne laisse pas supposer un simple feuilletage préalable.
Cet exposé graphique s'avère fort riche dans son ensemble. Il fait appel à de nombreux éléments cultures, par exemple : La cité de verre (1987) de Paul Auster, Moby Dick (1851), d'Herman Melville (1819-1891), la notion d'apercetion de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), La grande vague de Kanagawa (environ 1830) de Katsushika Hokusai (1760-1849), la qualité des pensées que l'on a en marchant d'après Friedrich Nietzsche (1844-1900), Blade Runner (1982) de Ridley Scott, l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg (1400-1468), la fable du scorpion et de la grenouille de Lev Nitoburg (1899-1937), le corps sans organe d'Antonin Artaud (1896-1948), l'utilité de l'inutile développé par Tchouang Tseu (-369 à -288), l'autobiographie de Corto Maltese (Le désir d'être inutile) par Hugo Pratt (1927-1995), lé dégénérescence des utopies par Claude Shannon (1916-2001, mathématicien, un des fondateurs de la théorie de l'information) & Norbert Wiener (1894-1964, père fondateur de la cybernétique), Bug (2017-2022) d'Enki Bilal, la notion de biopouvoir développée par Michel Foucault (1926-1984), le petit Prince (1943) d'Antoine Saint Exupéry (1900-1944), etc. Les auteurs savent apporter les informations nécessaires pour que tous les lecteurs puissent comprendre ces références et leur rapport avec l'exposé. Ainsi le lecteur saisit aisément la différence fondamentale entre le fonctionnement du cerveau et une intelligence informatique (Tout le corps pense… Pas seulement le cerveau.), la réalité déjà présente du transhumanisme (l'impact de l'omniprésence de l'information disponible en permanence par exemple), le problème avec le progrès (on voit ce qu'on gagne, mais on ignore ce qu'on perd), l'avènement de la société normative (ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas), le principe de mariage parfait qui unit aujourd'hui les technosciences et la macroéconomie néolibérale (deux formes d'une même dérégulation), etc.
Le titre indique clairement que les auteurs adoptent un point de vue partial sur la question, certainement pour compenser la généralisation et l'enthousiasme pour les technologies numériques sous toutes leurs formes. Malgré une apparence éloignée d'une bande dessinée traditionnelle, le lecteur se rend vite compte du confort de lecture, de l'intelligence de la mise en images, conçue sur mesure pour cet exposé graphique. Il apprécie les points de vue du philosophe grâce à la richesse des références, la clarté du propos, sans pour autant perdre son propre esprit critique. du grand art, de la réflexion très humaine.
Cet « essai dessiné » a pour but de vulgariser le livre de Miguel Benasayag qui porte à peu près le même titre : Cerveau augmenté, homme diminué. ● Il s'agit de montrer comment notre cerveau réagit au numérique, et tout particulièrement aux réseaux sociaux. Les auteurs visent à montrer que le cerveau n'est nullement analogue à un « super-ordinateur » à quoi on le compare souvent, mais a des spécificités que la machine n'a pas, mais que la machine peut esquinter ou diminuer en quantité comme en qualité. ● C'est donc un réquisitoire contre les prothèses numériques qu'on veut implanter dans l'humain, « on » étant bien sûr le « néolibéralisme » (what else ?) et les entreprises de la Silicon Valley. ● J'avoue que je n'ai pas les compétences pour juger de ce qui est dit là ; simplement la conclusion à laquelle ces prémices conduisent me paraît un peu trop politiquement correcte. Sous l'apparence de développements scientifiques, le texte est en réalité bourré d'idéologie. ● D'autre part, et c'est là l'essentiel puisque l'ouvrage nous est présenté comme un album de BD, il est difficile de concevoir une lecture plus rébarbative. ● On connaissait la BD muette (sans bulles) ; voici la BD sans images… La plupart des « images » consistent en effet en un fond uniforme de couleur taupe, sur lequel des gros plâtras de textes sont plaqués. ● de ce fait, quelle est la valeur ajoutée de la « BD » par rapport au livre de Benasayag ? Je ne comprends pas ce qu'ont voulu faire les auteurs. Mais tout ce que je peux dire c'est qu'en tant que lecteur, c'est une vraie purge ; j'ai rarement vu un truc aussi ennuyeux ! Je déconseille sauf aux masochistes. ● Je remercie NetGalley et les éditions Delcourt de m'avoir permis de lire cet ouvrage, mais pas Télérama qui en a fait l'éloge (je m'étais pourtant bien promis de ne plus jamais suivre une recommandation littéraire de ce magazine…)
Le propos est très intéressant, il traite de l'illusion de l'intelligence artificielle. le sujet est traité dans un sens technique et philosophique, j'ai appris et compris des choses, bien que cela enfonce quelques portes ouvertes, et j'ai trouvé certains arguments assez péremptoires et pas forcément si évidents pour autant, concernant la conscience des machines, ou plutôt l'absence de conscience.
J'ai pris ce livre à la médiathèque avec la caution de Thierry Murat, graphiste bédéaste que j'admire beaucoup. Serais-je allé vers un tel sujet de lecture sans ça, ce n'est pas certain, sans doute pas pour un essai, je pense que je ne serais pas allé plus loin qu'un article de journal.
Cette lecture me laisse insatisfait, le rapport entre le sujet et la narration graphique m'a vraiment déçu. Les auteurs font le choix d'incorporer leur rencontre dans ce récit, ça n'a rien à y faire, et c'est plutôt raté : Thierry Murat raconte sa lecture du livre de Miguel Benasayag, il reprend des passages entiers, avec une illustration juste décorative, très bien faite cependant, il maîtrise la bichromie, le trait est élégant, mais elle vient plutôt perturber la compréhension plus que l'éclaircir. Puis régulièrement, l'essai est interrompu par un café pris dans un bar ou un coup de fil et autres inutilités du genre.
La nécessité de mettre en image l'essai de Miguel Benasayag est plus que douteuse, si le sujet intéressait à ce point Thierry Murat, cela aurait pu déboucher sur une fiction passionnante, ou alors, qu'il se contente d'en faire la publicité, mais pour moi, cette rencontre entre l'essai et la bande dessinée est à côté de la plaque, et aurait tendance à jeter un flou sur le propos et à laisser planer le doute de l'enfumage, au lieu d'éclaircir le propos.
J'ai pris ce livre à la médiathèque avec la caution de Thierry Murat, graphiste bédéaste que j'admire beaucoup. Serais-je allé vers un tel sujet de lecture sans ça, ce n'est pas certain, sans doute pas pour un essai, je pense que je ne serais pas allé plus loin qu'un article de journal.
Cette lecture me laisse insatisfait, le rapport entre le sujet et la narration graphique m'a vraiment déçu. Les auteurs font le choix d'incorporer leur rencontre dans ce récit, ça n'a rien à y faire, et c'est plutôt raté : Thierry Murat raconte sa lecture du livre de Miguel Benasayag, il reprend des passages entiers, avec une illustration juste décorative, très bien faite cependant, il maîtrise la bichromie, le trait est élégant, mais elle vient plutôt perturber la compréhension plus que l'éclaircir. Puis régulièrement, l'essai est interrompu par un café pris dans un bar ou un coup de fil et autres inutilités du genre.
La nécessité de mettre en image l'essai de Miguel Benasayag est plus que douteuse, si le sujet intéressait à ce point Thierry Murat, cela aurait pu déboucher sur une fiction passionnante, ou alors, qu'il se contente d'en faire la publicité, mais pour moi, cette rencontre entre l'essai et la bande dessinée est à côté de la plaque, et aurait tendance à jeter un flou sur le propos et à laisser planer le doute de l'enfumage, au lieu d'éclaircir le propos.
Thierry Murat, frappé par la lecture de Cerveau augmenté, homme diminué de Miguel Benasayag, le contacte et le convainc de « prolonger graphiquement son livre », de dessiner les réflexions qu'il a suscitées et leurs échanges, chapitre après chapitre. Ils évoquent ainsi la colonisation numérique de notre société, les dérives des neurosciences et du transhumanisme, les dangers de l'hybridation entre l'homme et la machine.
(...)
Thierry Murat met en cases et en bulle, comme il le mettrait en scène, le texte de Miguel Benasayag. Il incarne sous forme dialogique la pensée de celui-ci, dans un souci de vulgarisation. Quant à l'auteur, il se complait dans une certaine ambiguïté, considérant que les technologies, dont il dénonce pourtant longuement les mécanismes et les effets, seraient neutres et pourraient être affectées à un noble objectif, à condition de prendre le temps d'une « coévolution », que la vie et la culture les colonisent ! Si son analyse est extrêmement fine et plonge dans la complexité, philosophique comme technique, de la révolution numérique, ses mises en gardes argumentées, ses conclusions restent donc superficielles. Libre au lecteur d'en tirer de tout autres.
Article complet sur le blog de la Bibliothèque Fahrenheit 451 :
Lien : https://bibliothequefahrenhe..
(...)
Thierry Murat met en cases et en bulle, comme il le mettrait en scène, le texte de Miguel Benasayag. Il incarne sous forme dialogique la pensée de celui-ci, dans un souci de vulgarisation. Quant à l'auteur, il se complait dans une certaine ambiguïté, considérant que les technologies, dont il dénonce pourtant longuement les mécanismes et les effets, seraient neutres et pourraient être affectées à un noble objectif, à condition de prendre le temps d'une « coévolution », que la vie et la culture les colonisent ! Si son analyse est extrêmement fine et plonge dans la complexité, philosophique comme technique, de la révolution numérique, ses mises en gardes argumentées, ses conclusions restent donc superficielles. Libre au lecteur d'en tirer de tout autres.
Article complet sur le blog de la Bibliothèque Fahrenheit 451 :
Lien : https://bibliothequefahrenhe..
Cet album adapte l'essai de Miguel Benasayag du même nom.
Premier problème, le graphisme. Ou plutôt l'absence de graphisme. La BD se contente de cases gris taupe, avec quelques micro-dessins blancs qui arrivent un peu comme des cheveux sur la soupe. Dans ce genre d'ouvrage, les dessins sont sensés clarifier et expliquer les notions. Ici, rien de ce genre pour aider à la compréhension.
Parce que côté compréhension, là aussi ce n'est pas gagné. le déroulé est une conversation entre Miguel Benasayag, auteur de l'essai initial, et Thierry Murat, qui l'adapte. On nous explique les notions présentées dans l'essai, mais j'ai appréhendé, voire abscons par moment, même si j'ai compris les grandes lignes. J'ai aussi eu l'impression de tourner en rond avec des redites. Ensuite, au niveau des idées exposées ici, je trouve qu'on se rapproche plus de la philosophie que de la science.
Je ne suis pas vraiment sûre de ce que voulaient nous proposer les auteurs avec cet album, mais pour moi, ce n'est pas réussi.
Premier problème, le graphisme. Ou plutôt l'absence de graphisme. La BD se contente de cases gris taupe, avec quelques micro-dessins blancs qui arrivent un peu comme des cheveux sur la soupe. Dans ce genre d'ouvrage, les dessins sont sensés clarifier et expliquer les notions. Ici, rien de ce genre pour aider à la compréhension.
Parce que côté compréhension, là aussi ce n'est pas gagné. le déroulé est une conversation entre Miguel Benasayag, auteur de l'essai initial, et Thierry Murat, qui l'adapte. On nous explique les notions présentées dans l'essai, mais j'ai appréhendé, voire abscons par moment, même si j'ai compris les grandes lignes. J'ai aussi eu l'impression de tourner en rond avec des redites. Ensuite, au niveau des idées exposées ici, je trouve qu'on se rapproche plus de la philosophie que de la science.
Je ne suis pas vraiment sûre de ce que voulaient nous proposer les auteurs avec cet album, mais pour moi, ce n'est pas réussi.
Citations et extraits (22)
Voir plus
Ajouter une citation
Leibnitz, le très optimiste philosophe allemand du XVIIe siècle, dans ses Nouveaux essais sur l’entendement humain, nous propose une méthode. Imaginons d’abord trois niveaux. Le premier la perception. Le deuxième l’aperception. Le troisième la conscience. 1 Ay stade premier de la perception seule, l’organisme reçoit un stimulus. Cette simple information ne lui suffit pas pour agir. Le vivant sera seulement affecté de manière simple et passive et ne pourra réagir avec les conséquences que son milieu détermine : se dissoudre, se brûler s’intoxiquer, etc. 2 C’est dans la deuxième phase, l’aperception, que le vivant a la possibilité d’agir. Non plus seulement en réaction mécanique passive (se consumer, se décomposer…), mais selon les caractéristiques propres à chaque organisme. Pour un même stimulus, une multitude d’agissement diffèreront selon les êtres vivants. Prenons alors le temps d’observer cette allégorie en forme de haïku. Sur le lac, tout est calme et tranquille. Soudain, le pêcheur donne un coup de rame dans le fond de sa barque… Pok ! Au même instant, le poisson file vers les eaux profondes et l’oiseau s’échappe en plein ciel. Chacun à la verticale. Chacun vers sa propre histoire. Sa propre réalité… Sa propre aperception. Leibniz nous suggère pour mieux comprendre ce concept d’aperception, de regarder et surtout d’écouter une vague. Chaque corps, affecté par le bruit produit par les millions de micro-gouttes composant une vague, perçoit ces ondes sonores et réagit ou non mécaniquement, à ces millions de mini-stimuli. Mais pour qu’existe ensuite l’aperception d’une vague, il faut que, de manière infinitésimale, des millions de micro-gouttes aient interagi avec le corps. Au niveau de la simple perception, par la seule interaction des gouttes avec l’air, la terre nos tympans et nos corps, nous ne pouvons pas apercevoir la vague. Mais à partir d’un socle donné, son image émerge en interaction avec notre ouïe, notre corps et notre système nerveux central. Les phénomènes liés à ce socle varient en fonction de chaque espèce. Ainsi, pour la plupart des mammifères, l’effet socle produira l’image auditive de la vague. Mais pour des fourmis (ou des microbes…), ces êtres vivants minuscules qui vivent dans un autre monde perceptif, les socles d’aperception détermineront que la vague n’a tout simplement jamais existé. 3 Si nous poursuivons l’analyse de Leibniz, nous arrivons enfin à un troisième niveau, celui de la conscience. Les organismes possédant un cerveau capable de produire des images conscientes, à partir des aperceptions, géométrisent le monde pour le reconnaître. Et dans le cas de la conscience humaine, il existe même la possibilité d’au moins un quatrième niveau… 4 Cette dimension supplémentaire, celle d’être conscient, appelons-la de manière totalement subjective la Connaissance.
Tous les produits Tech de la Silicon Valley ou d’ailleurs (applications, jeux, services numériques, réseaux sociaux…), de par leur conception, sont pensés en s’appuyant sur des fragilités, ou faiblesses psychologiques (besoin d’attention, de reconnaissance, solitude, apathie, etc.). L’effet dopamine s’inscrit dans une logique appelée la conception persuasive chez les géants de la tech. Avec la course aux likes sur Instagram ou avec Snapchat et son système de flammes à entretenir tous les jours dans les échanges (sorte de récompense virtuelle pour avoir passé suffisamment de temps sur l’application…), les effets sont dévastateurs chez les jeunes adolescents en matière de dépendance, d’estime de soi, de maîtrise des émotions, d’attention, de concentration, et bien sûr de construction cognitive… Ces mécanismes mettent en jeu une série de boucles neuronales ultrarapides qui rendent de plus en plus difficile la possibilité de pensées complexes, exigeant un autre type de temporalité et d’attention, une temporalité plus ample et plus dense. Se concentrer, c’est toujours privilégié des stimuli ennuyeux qui ne libèrent pas en cascade les chaînes de neuromédiateurs des circuits de récompense et de plaisir immédiat.
On s’imagine souvent que la bande dessinée doit formellement et absolument mettre en scène des bonshommes à gros nez, bavardant frénétiquement à grands coups de phylactère ovoïde… Certains d’entre vous auront alors été un peu déstabilisés à la lecture des premières pages du présent ouvrage, où je m’essaie librement à ce genre nouveau que les éditeurs, les libraires et les journalistes de la modernité ont baptisé : l’essai graphique. Il s’agit surtout, là aussi, de créer un monde pour inventer une forme narrative. Ne pas prendre le lecteur pour un âne. Et ne pas se mentir sur ce qu’on nomme aujourd’hui communément la vulgarisation scientifique. Ne pas se contenter de penser que l’on a trouvé ce qu’on cherche en illustrant un catéchisme savant… Ne pas se faire croire que le lecteur doit systématiquement être en position confortable. Chercher. Essayer… Oser surestimer ce qui se passe entre les cases, et y explorer cette temporalité alternative de la lecture que permet le médium Bande dessinée. Les idées visuelles enfermées dans des cases ne sont rien avant de prendre corps entre les mains du lecteur. Libre à lui d’en faire des points d’exclamation, d’interrogation, ou de suspension. Après tout, le cerveau construit un monde… Et pour comprendre cette production de réalité, il faut d’abord préciser la différence radicale qu’il y a entre Information et Connaissance.
Les trois premières blessures narcissiques, infligées par la science à l’homme dans l’histoire de l’Occident, on le sait, furent douloureuses et le sont peut-être encore. La première déclenchée par Copernic et Galilée : non seulement la Terre n’est pas au centre de l’univers, sous le regard de plein d’amour paternel de Dieu, mais elle n’est qu’un simple caillou parmi tant d’autres, perdu dans l’infini intersidéral. La deuxième, causée par Darwin : nous autres les humains, qui occupons une place tellement spéciale dans la Création divine du vaste monde, ne sommes en définitive que des proches cousins du singe, à peine plus évolués et beaucoup moins poilus. La troisième, provoquée par Freud en personne : nous, les êtres humains, ne somme que des marionnettes de pulsions et de désirs, manipulées par notre inconscient. Quatre, en réalité, cette quatrième blessure narcissique est peut-être légèrement antérieure à la modélisation in vivo des mécanismes cérébraux élaborée dès le début des années 2000. De manière symbolique et certes un peu arbitraire, on peut considérer que l’ordinateur Deep Blue d’IBM fut le premier coup porté, la première offense à la dignité de l’intelligence humaine. En février 1996 à Philadelphie, le champion du monde d’échecs, Gary Kasparov, va se battre sans relâche contre un ordinateur qui déjoue toutes ses parades en calculant jusqu’à 200 millions de positions par seconde.
Il y a une dizaine d’années, des chercheurs en neurophysiologie avaient constaté que chez des gamers réguliers, la structure cérébrale se modifie au niveau des zones préfrontales qui deviennent plus épaisses. Les geeks du monde entier étaient ravis de l’apprendre, mais ils ignoraient la contrepartie de la fausse bonne nouvelle. Les études sur la plasticité du cerveau démontrent aujourd’hui de manière incontestable que lorsque ces zones préfrontales s’affinent, c’est un signe de développement de l’intelligence (et non l’inverse).
Videos de Miguel Benasayag (5)
Voir plusAjouter une vidéo
Miguel Benasayag vous présente son ouvrage "Les nouvelles figures de l'agir : penser et s'engager depuis le vivant" aux éditions La Découverte. Entretien avec Nicolas Patin.
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2441161/miguel-benasayag-les-nouvelles-figures-de-l-agir-penser-et-s-engager-depuis-le-vivant
Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2441161/miguel-benasayag-les-nouvelles-figures-de-l-agir-penser-et-s-engager-depuis-le-vivant
Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat
+ Lire la suite
autres livres classés : essai graphiqueVoir plus
Les plus populaires : Bande dessinée
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Miguel Benasayag (28)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les personnages de Tintin
Je suis un physicien tête-en-l'air et un peu dur d'oreille. J'apparais pour la première fois dans "Le Trésor de Rackham le Rouge". Mon personnage est inspiré d'Auguste Piccard (un physicien suisse concepteur du bathyscaphe) à qui je ressemble physiquement, mais j'ai fait mieux que mon modèle : je suis à l'origine d'un ambitieux programme d'exploration lunaire.
Tintin
Milou
Le Capitaine Haddock
Le Professeur Tournesol
Dupond et Dupont
Le Général Alcazar
L'émir Ben Kalish Ezab
La Castafiore
Oliveira da Figueira
Séraphin Lampion
Le docteur Müller
Nestor
Rastapopoulos
Le colonel Sponsz
Tchang
15 questions
5274 lecteurs ont répondu
Thèmes :
bd franco-belge
, bande dessinée
, bd jeunesse
, bd belge
, bande dessinée aventure
, aventure jeunesse
, tintinophile
, ligne claire
, personnages
, Personnages fictifsCréer un quiz sur ce livre5274 lecteurs ont répondu